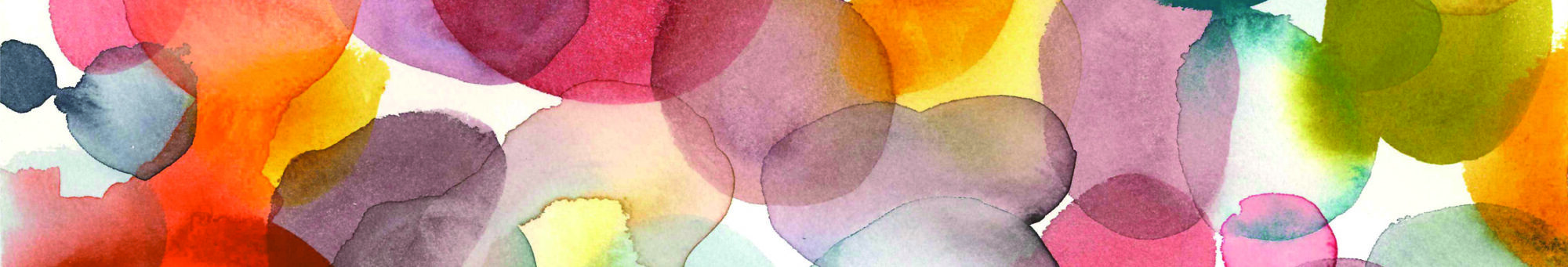Episode 1
Un jour, à Dorinne, j’ai eu sous les yeux l’image du bonheur, et je n’avais pas d’appareil photo pour l’immortaliser. J’étais reconnaissante de cette circonstance : cela me donnait l’occasion de l’écrire et je savais que je m’en souviendrais encore mieux comme ça.
Une fillette sur la balançoire accrochée à la grosse branche du catalpa. L’arbre se dresse sur le coin de la prairie, à côté du chemin de cailloux qui descend en tournant vers la rivière. Le bleu du ciel et les dégradés de vert du catalpa, de la pelouse et de la colline derrière, sur l’autre rive, sont saisissants. La queue de cheval de la fillette danse au vent, au même rythme que le manteau dont elle a noué les manches autour de sa taille, parce que les beaux jours sont de retour et qu’il fait bon dehors sans veste. Elle crie sa joie, elle appelle cette nature dans laquelle elle se fond, qu’elle respire à pleins poumons après deux mois de confinement. Elle se cramponne aux cordes de la balançoire et va de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus fort. La joie qu’elle ressent à sentir cette puissance s’ouvrir en elle est contagieuse. L’arbre la soutient de toute sa force tranquille.
J’étais d’autant plus heureuse de l’écrire, de la savourer encore mieux, que c’était la fin de l’enfance. Après, bientôt, il y aura bien sûr toujours ces deux êtres que j’ai tant de plaisir à côtoyer, et il restera en souvenir ces cris de joie, cette insouciance, cette candeur qui sont tellement propres à l’enfance. Et tout ça, c’est gagné, c’est bien au chaud dans un coffre aux trésors, dans une multitude d’images dont, je pense, je n’arrêterai jamais de faire la liste.
Episode 2
Le matin, elle est à l’arrière de mon vélo. C’est un bon vélo électrique, elle est sur le portebagage, elle adore que je la conduise à l’école, et moi je me lève plus tôt juste pour pouvoir le faire. Elle serait assez grande pour pédaler, elle serait même assez grande pour aller à l’école toute seule, mais elle babille derrière moi, et moi je l’écoute me raconter sa vie, ses amis, ses préoccupations, son professeur embêtant. On dirait qu’elle a moins que son âge et je savoure ces derniers moments d’enfance.
Si on adore tant aller à l’école ensemble à vélo, c’est surtout parce qu’on passe par le petit bois du Keyenbempt. Au milieu du petit bois, il y a un ruisseau, mais il n’y a pas de pont. Il faut le traverser à gué, en faisant passer le vélo sur les pierres qui dépassent tout juste du niveau de l’eau, sans mouiller nos sacs accrochés à l’arrière. Alors on met pied à terre, et là, on entend les frémissements du ruisseau, les piaillements des oiseaux, les frissonnements des feuilles des arbres, et on respire l’air frais de l’aurore chargé de rosée. Qui au monde a la chance de traverser un ruisseau à gué chaque matin ? Nous sommes là, juste à nous deux, en pleine nature. Au loin, le grondement étouffé des voitures qui brûlent leurs gaz puants sur du goudron gris pour rouler au pas entre des murs. Et nous deux, seules, immensément privilégiées d’être dans ce petit bois rien qu’à nous. Ou presque : on y croise parfois un promeneur qui flâne avec son chien, rarement un autre parent qui conduit un autre enfant à une autre école sur un autre vélo. Regard complice : ce moment est délicieux, il nous appartient. Pas besoin de se parler pour savoir à quel point cet instant nous rend heureuses. Et même si maintenant les écoles sont fermées, le ruisseau, le petit bois, le vélo et les bruits dans les arbres sont toujours là. Aucune épidémie ne nous a pris ce moment-là.
Episode 3
Depuis quinze ans, il y a un figuier dans le jardin. Et depuis trois ans, le figuier nous donne des figues. Pendant l’été, on se régale de l’ombre de cet arbre qui chaque année devient de plus en plus majestueux, étend ses feuilles, étire ses branches, offre ses fruits au soleil pour les faire mûrir.
Tous les Espagnols le savent : les figuiers perdent leurs feuilles presque en un coup. Entre le jour où la première feuille tombe et le jour où il se retrouve dans sa nudité d’hiver, il se déroule une semaine, tout au plus dix jours. Et pendant ces dix jours, on se met à les apercevoir, et puis à les distinguer clairement, ces figues dodues qui s’étaient cachées de nous pour mûrir. Elles sont là, elles sont prêtes. On secoue un peu l’arbre bien-aimé et il nous envoie une salve malicieuse de fruits. On marche sur un épais tapis de feuilles en prenant garde de ne pas écraser les figues tombées au sol pendant la nuit, dissimulées sous les feuilles mortes.
Le matin, dans le froid et la lumière blanche et oblique, on cueille à mains nues des figues glacées que le gel a fissurées. Elles laissent entrevoir leur chair rouge, comme une promesse. Et alors, comment résister à l’invitation ? On en prend une entre les doigts, encore couverte de petits cristaux de glace. On pousse légèrement sur elle, à deux doigts, et elle se déchire en deux. Et les petites pépites glacées éclatent sur la langue. Elles sont pleines de mille saveurs.
Ça non plus, l’épidémie ne nous l’a pas enlevé.

Autrice, co-fondatrice de La Pachamama Fair Play https://www.lapachamama.eu/